Il est facile de faire dire aux textes saints ce que l’on veut. Nombreux s’y sont employés, mais avec le temps nous y voyons plus clair. Beaucoup plus claire. La femme a toujours été l’égale de l’homme en religion. Le FNJ ne nous fera pas croire le contraire.
FNJ : misogynie ou lecture masculine des textes religieux
 Sur un sujet où il n’y a pas de consensus, Le FNJ choisit la position radicale et essaie de la faire passer pour un consensus religieux. Il affirme qu’en islam, la femme ne peut pas gouverner. Ce qui est une des lectures possibles des textes religieux. Il y en a d’autres et le Front National pour la Justice a omis de les mentionner. Des essayistes comme la Dr Asma Lamrabet, figure connue du féminisme islamique, ont pu démontrer en se basant sur la sunna du prophète, le coran et les commentaires de nombreux exégète comme Ibn Achour, comment la gente masculine essaie de s’accaparer les textes sur ce sujet, jusqu’à omettre de citer le nom des femmes qui ont accompli des actes politiques.
Sur un sujet où il n’y a pas de consensus, Le FNJ choisit la position radicale et essaie de la faire passer pour un consensus religieux. Il affirme qu’en islam, la femme ne peut pas gouverner. Ce qui est une des lectures possibles des textes religieux. Il y en a d’autres et le Front National pour la Justice a omis de les mentionner. Des essayistes comme la Dr Asma Lamrabet, figure connue du féminisme islamique, ont pu démontrer en se basant sur la sunna du prophète, le coran et les commentaires de nombreux exégète comme Ibn Achour, comment la gente masculine essaie de s’accaparer les textes sur ce sujet, jusqu’à omettre de citer le nom des femmes qui ont accompli des actes politiques.
Comme cette femme anonyme, citée dans de nombreux récits historiques, qui interpella le calife Omar au cours de la prière du vendredi, quand Omar voulut limiter le nihla (dot) à un montant qu’il avait fixé lui-même : « Tu ne nous reprendras pas ce que Dieu nous a donné ! » , disait-elle. Et Omar d’affirmer devant toute l’assemblée, « cette femme a raison et Omar a tort ». Voilà un acte politique. Et l’histoire n’a pas voulu retenir le nom de cette femme. Comme s’il voulait en effacer son existence.
En fait, le coran n’a pas tranché de manière explicite, sur le modèle d’organisation politique. On y retrouve des principes définis de manière globale, comme ceux de la consultation et du respect dû aux représentants élus du peuple. Le coran a aussi été clair quant à la dénonciation de la tyrannie politique, des gouvernants injustes et des despotes comme pharaon. Il a ainsi posé les bases d’une gouvernance, basée sur la justice et l’équité.
Cette équité se retrouve dans le langage utilisé par le coran, en s’adressant le plus souvent de manière générale aux humains ou en interpellant les deux sexes successivement. « Ô vous les gens », « ô vous qui croyez », « vous les croyants et les croyantes »… Voilà comment le plus haut s’est adressé à nous. De manière égale.
On trouve aussi dans le coran, l’histoire de Bilquiss, la reine de Saba. Décrite dans le coran, comme une démocrate absolue, elle était très attachée aux principes de la consultation. Jusqu’à ce que le coran l’érige en modèle de dirigeante politique juste. Dirigeante politique juste.
Il y a aussi dans le coran les concepts de khilafah et wilayah, qui suffisent à eux deux, pour démontrer l’égalité évidente que confère le coran, à la participation politique des hommes et des femmes. Ils doivent assumer tous deux, la responsabilité de la gestion de la vie terrestre (khilafah), en faisant une alliance pour l’intérêt commun, l’égalité et la justice pour tous (wilayah).
La lecture du FNJ, ne se base sur aucun récit du saint coran. Il porte sur un hadith assez discutable, transmis par Abu Bakra (à ne pas confondre avec Abu Bakr Al-suddiq) et qui affirme : « Qu’un peuple ne pourrait réussir s’il est dirigé par une femme ». Nafii Ibn el Harith de son vrai nom, a révélé ce hadith 28 ans après la mort du prophète, à un moment où la politique avait pris le dessus sur le religieux. Quand les ambitions de Muawiya ont conduit à la fracture entre sunnite et chiite.
Beaucoup de savants de l’époque ont refusé de participer à cette divergence politique, par peur de la fitna (la division). Il faudra noter qu’Abu Bakra a été condamné sous le calife d’Omar Ibn Al Khatab pour faux témoignage et le calife n’acceptait plus dès lors, aucune de ces attestations.
Il est évident que ce hadith, à ce moment précis, est fortement politisé. Abu Bakra en avait l’habitude et sa personnalité n’est pas totalement saine vu sa condamnation et sa facilité à relater des hadiths politisés comme quand il rapporte que « celui qui méprise le sultan de Dieu sur terre, Dieu le méprisera ». Des récits qui relèvent selon nombreux commentateurs de la « morale de dissuasion » (atarghib wa atarhib).
Difficile de comprendre le poids qu’a pu prendre ce hadith controversé, jusqu’à mettre aux oubliettes d’autres hadith en faveur de la femme. Comme celui où le prophète dit : « Les femmes sont les semblables des hommes ». Rien que ça. Le prophète a tranché et les hommes qui l’ont suivi viennent ajouter des conditions sur telles et telles dispositions. Le prophète a dit « semblable » ; « chakaikou » et le mot en arabe et les linguistes ne trouveront aucune autre traduction à part « semblable, pareille, … ».
La position du FNJ démontre la misogynie profonde de ce parti. Il n’est pas question de respecter les textes religieux, mais plutôt de continuer ce que nombreux ont commencé il y a des siècles, contre les femmes musulmanes. Vu que les traditionalistes font tout ce qui leur est possible de faire pour limiter les droits des femmes, réfuter l’égalité entre les sexes qui est une promesse de la religion musulmane, il ne reste qu’à légiférer sur la possibilité de tuer les petites filles, comme ce fût le cas avant l’islam. Dans ce papier, nous n’avons pas essayé de nous faire passer pour des érudits. Nous ne le sommes pas. Mais comme le Dr Asma Lamrabet, essayiste féministe musulmane, qui a beaucoup écrit sur le sujet (nous nous en sommes d’ailleurs référé ), nous avons compris que pour se battre avec l’intolérance et la misogynie dans la religion, il fallait chercher les arguments dans la religion. L’islam n’a pas été et ne sera jamais une religion sexiste. La femme a toute sa place dans la politique. Et il y aura toujours des musulmans pour rappeler que l’égalité est la règle. Comme l’a affirmé le prophète et comme nous le montre le coran. Tous égaux devant dieu et tous égaux devant les hommes. Soyons intègres, soyons citoyens, soyons Comoriens, et le meilleur suivra.
Khaled SIMBA






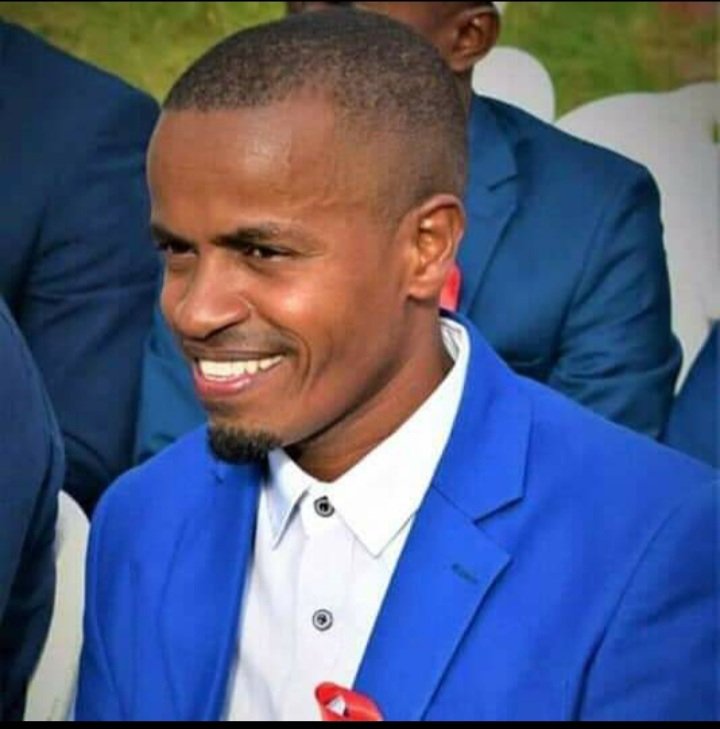
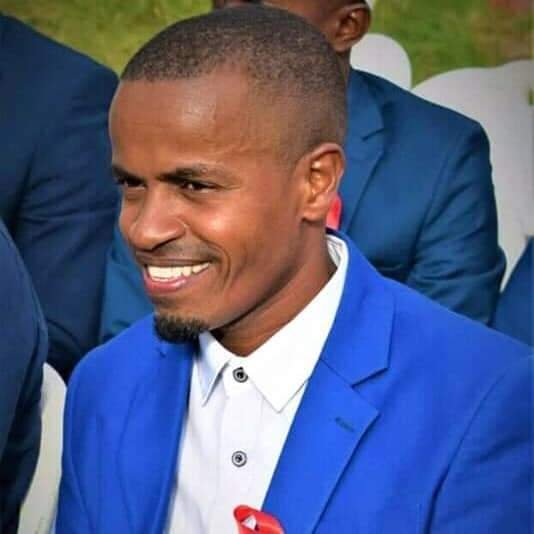




 Sur un sujet où il n’y a pas de consensus, Le FNJ choisit la position radicale et essaie de la faire passer pour un consensus religieux. Il affirme qu’en islam, la femme ne peut pas gouverner. Ce qui est une des lectures possibles des textes religieux. Il y en a d’autres et le Front National pour la Justice a omis de les mentionner. Des essayistes comme la Dr Asma Lamrabet, figure connue du féminisme islamique, ont pu démontrer en se basant sur la sunna du prophète, le coran et les commentaires de nombreux exégète comme Ibn Achour, comment la gente masculine essaie de s’accaparer les textes sur ce sujet, jusqu’à omettre de citer le nom des femmes qui ont accompli des actes politiques.
Sur un sujet où il n’y a pas de consensus, Le FNJ choisit la position radicale et essaie de la faire passer pour un consensus religieux. Il affirme qu’en islam, la femme ne peut pas gouverner. Ce qui est une des lectures possibles des textes religieux. Il y en a d’autres et le Front National pour la Justice a omis de les mentionner. Des essayistes comme la Dr Asma Lamrabet, figure connue du féminisme islamique, ont pu démontrer en se basant sur la sunna du prophète, le coran et les commentaires de nombreux exégète comme Ibn Achour, comment la gente masculine essaie de s’accaparer les textes sur ce sujet, jusqu’à omettre de citer le nom des femmes qui ont accompli des actes politiques.